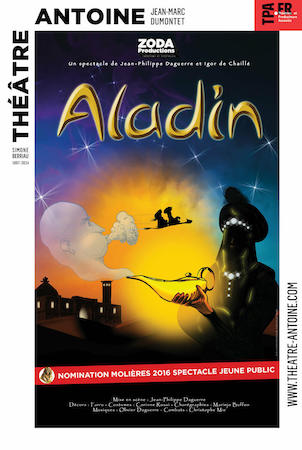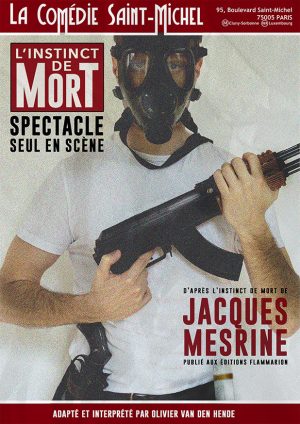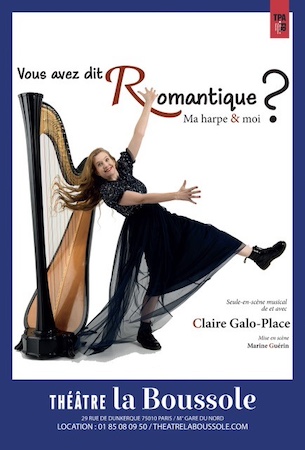Cannes 2019, épisode 1 : night shop
C’est avec un malin plaisir que l’organisation du festival change chaque année un peu les règles d’accès aux projections des films pour la presse. Cannes commence donc toujours un peu sur une montée de stress : quelle couleur de badge m’a t-on accordé cette année ? Et surtout : Cela va t-il suffire pour voir les films ? Je me retrouve comme les années précédentes avec mon badge bleu. Mais autour de moi de nombreux collègues et amis ont été rétrogradés. C’est la première humiliation du festival et jamais on ne sait vraiment pourquoi. Dans le flou, on ne peut analyser que c’est parce qu’on est personne pour le festival. Et oui, en réalité. Ils et elles sont peu à avoir tous les privilèges. Et les très belles et très populaires personnalités du cinéma et des médias semblent ici aussi appartenir à un autre monde.
Nous, on est dans le monde où la couleur de badge compte. En réalité, cette couleur et la facilité ou pas à accéder aux projections c’est surtout des conditions de travail plus ou moins facilitées. Certains et certaines perdront beaucoup de temps à attendre pour ne pas voir les films. Et recommencerons pourtant encore et encore. Dans l’espoir que ça passe. Dans l’espoir de voir le film.
Me voilà donc bleue avec mon badge avec une faute à mon prénom et une photo un peu flatteuse datant de quelques années en arrière. Je sais très bien qu’au bout d’une semaine, les vigiles du palais regarderont la photo longuement puis longuement également mon visage défait dans une sorte de commentaire désagréable de mon état de santé (et de beauté) général. Pardon donc par avance d’avoir l’air plus vieille et plus fatiguée. Plus tard complètement décalquée. Parfois, je l’avoue, un peu alcoolisée. Work hard, play hard comme on dit.
Et ce n’est pas comme si c’était un secret. Les soirées, si elles ne sont plus ce qu’elles étaient, existent encore à Cannes. Du rosé est servi sur la grande terrasse des journalistes et quiconque a déjà mis les pieds en deuxième partie de festival à une projection de 8h30 s’est probablement retrouvé à côté de quelqu’un empestant encore franchement l’alcool. Ça m’est arrivé plus d’une fois. Mais je respecte. La personne en question est une nuisance pour ses voisins et voisines de siège mais elle a quand même trouvé le courage de se déplacer en projection alors que le soleil se lève à peine au lieu de cuver dans le canapé où elle a élu domicile pendant 2 semaines. Quel engagement pour le cinéma !
C’est le même engagement qui pousse à repousser ses limites physiques pour enchaîner les projections, les interviews, la rédaction effrénée d’articles pendant 2 semaines. À ne tenir qu’avec un verre d’eau dans le ventre et un croissant acheté en 3 secondes (vive le sans contact) dans une boulangerie ouverte sur le chemin entre son appartement et la salle du réveil jusqu’à 15h. En même temps, la digestion ça fait dormir… alors autant ne pas trop manger.
Le premier jour déjà, j’ai vu des journalistes ingurgiter des pommes et des gâteaux en quelques minutes devant le regard désapprobateur de la sécurité des salles. Des dizaines de bouteilles d’eau encore pleines jetées. C’est absurde. Et pourtant ça fait aussi partie du festival. Il faut vivre pendant la quinzaine avec le sentiment d’être personne et celui de devoir survivre. Survivre pour vivre.
Et ce qu’il y a à vivre n’a pas de prix. Applaudir avec ses camarades le lancement du festival dans la salle Debussy, avec ceux et celles qui n’ont pas accès à la grande salle de Gala et ses paillettes. Avoir tous les ans cette même émotion en entendant la musique de la vidéo de la Quinzaine des Réalisateurs. Savoir combien nous sommes des privilégiés de voir ces films, de les découvrir avant le monde entier, parfois même avant l’équipe. Rire ensemble. Pleurer ensemble. Applaudir quand on en ressent l’envie. Parce que c’est la passion qui s’exprime. Une passion partagée par tous ici.
Si le festival s’est ouvert sur la séance de The Dead don’t die de Jim Jarmusch et que le résultat est largement en dessous des espérances (tout ça pour une maintenant convenue critique de la société de consommation), la pizza (Pizza Cresci pour ceux qui se demandent) qui a suivi a, elle, tout à fait rempli son contrat. Ensemble, on a parlé de cinéma mais c’est surtout le monde qu’on a refait. Et ces débats enflammés font presque partie du festival. Les films, on ne les oublie pas quelques secondes à peine après les avoir vus. Il faut les analyser, les comprendre, en dégager des points forts et des points faibles et aussi toujours assumer sa position et son sentiment.
Le lendemain matin, j’avais choisi de me lever à l’aube pour découvrir le nouveau film de Quentin Dupieux, Le Daim, avec Jean Dujardin. Le film est un délice d’absurde comme Quentin Dupieux sait le faire mais sa petite musique est paresseuse. En tout cas, elle me ravit moins que pour le burlesque Au poste. Jean Dujardin et Adèle Haenel, y sont, pourtant magistraux.
Bull, présenté en Un Certain Regard est un premier film puissant. Sa réalisatrice, Annie Silverstein dresse avec rigueur et bienveillance le portrait d’une femme en devenir dans un milieu hostile, au coeur du Texas pauvre, entre drogue, mère emprisonnée, et rodéos.
Je décide de faire la queue longtemps pour m’assurer une place pour Les Misérables (photo) de Ladj Ly, présenté en compétition, dont j’attends énormément. En 2017, le court métrage du même titre était en lice pour le prix du meilleur court métrage aux César, il était reparti bredouille malgré 15 minutes de pur choc. Depuis quelques heures, la Croisette s’enthousiasme par avance. Elle frétille d’impatience. J’entends à tous les coins de couloirs combien c’est difficile de décrocher une interview avec le réalisateur chouchou issu du collectif Kourtrajmé. Dans la salle, c’est en effet une claque. Ladj Ly joue des rythmes et emporte le spectateur dans une plongée asphyxiante dans les tours de Montfermeil à faire rougir Jacques Audiard et son Dheepan cliché. C’est un film du dedans et du dehors, un film d’urgence et un film d’espoir. La violence de sa jeunesse n’est là que pour nous rappeler combien elle est vivante et combien elle est outrée par l’injustice.
Après, il faut redescendre. Il faut sortir sur la croisette courir pour une invitation à une soirée, il faut aller faire la queue dans un fast-food entre starlettes et vigiles qui croquent dans un cheeseburger. Et puis, on revient au palais. Toujours, il faut en sortir et s’éloigner avant de replonger dans la bataille. C’est là qu’on respire à nouveau. On contourne le palais en passant par des chemins à l’abri des regards. Entrée des artistes. Ascenseur, 6 étage et on se retrouve au Monton-Cadet Wine Bar à siroter un rosé délicieux en regardant le soleil se coucher lentement sur la mer. C’est un moment absurde comment on en vit souvent à Cannes. Dans ce lieu où les privilégiés côtoient les piques assiettes, je ne me sens pas à ma place avec mon sac lourd de tout le matériel pour faire mon travail, mes chaussures confortables, mon imper rose parce que le matin il a plu. Mais je suis là. Je profite de ce luxe fou. Je me sens au dessus du monde. La tête encore pleine de films.
La nuit tombe et il est temps de voir Bacurau, présenté en compétition. Une chronique villageoise dans un bourg perdu du Brésil et puis un tournant inattendu, pas très réussi, qui vient casser la grâce. J’en ressors déçue parce que j’ai un goût de gâté dans la bouche. Un goût de possible, d’espoir et celui d’un auto-sabotage. Je ne sais vraiment ce que j’ai vu. Mais si ce n’était pas réellement déplaisant, ce n’est pas réussi.
Il est tard, il fait froid, la journée a été longue. Je suis alourdie par la déception et je veux rentrer me coucher. Mais un message arrive : « j’ai 4 places pour la soirée d’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs ». Nous sommes 5 mais on y va quand même. Sur place, sans surprise, refus du vigile de nous faire entrer. J’envisage de suivre mon plan initial et de retrouver le canapé non convertible qui me sert de lit pendant la quinzaine. Mais je me retourne et une femme me tend une invitation. Mince, ça ne se refuse pas, non ? On dit « on boit une coupe et on rentre ». Il n’y a plus de champagne à cette heure tardive donc la coupe se transforme en vodka puis en pintes de bières. Je rentre à 2 heures du matin, après avoir dansé, après avoir chanté, après avoir eu du sable dans mes chaussures et avoir grignoté des macarons. J’ai posé avec le blouson en daim du film de Quentin Dupieux, star de la soirée. Je ne regrette pas. Ici, il ne faut jamais regretter. Juste vivre comme si demain n’existait pas.
Articles liés

“Riding on a cloud” un récit émouvant à La Commune
A dix-sept ans, Yasser, le frère de Rabih Mroué, subit une blessure qui le contraint à réapprendre à parler. C’est lui qui nous fait face sur scène. Ce questionnement de la représentation et des limites entre fiction et documentaire...

“Des maquereaux pour la sirène” au théâtre La Croisée des Chemins
Victor l’a quittée. Ils vivaient une histoire d’amour fusionnelle depuis deux ans. Ce n’était pas toujours très beau, c’était parfois violent, mais elle était sûre d’une chose, il ne la quitterait jamais. Elle transformait chaque nouvelle marque qu’il infligeait...

La Croisée des Chemins dévoile le spectacle musical “Et les femmes poètes ?”
Raconter la vie d’une femme dans sa poésie propre, de l’enfance à l’âge adulte. En découvrir la trame, en dérouler le fil. Les mains féminines ont beaucoup tissé, brodé, cousu mais elles ont aussi écrit ! Alors, place à leurs...